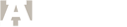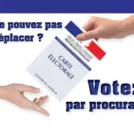Préhistoire à Sainte-Foy-de-Peyrolières et dans les environs
300 000 à 70 000 années avant notre ère – Présence d’Homo Néandertalis sur la commune.
35 000 années avant notre ère – Présence d’Homo Sapiens à Aurignac.
5ème millénaire avant notre ère – Peuplement néolithique en vallée de la Garonne.
3ème millénaire avant notre ère – Des populations du Moyen Orient en Occitanie.
Histoire antique à Sainte-Foy-de-Peyrolières et dans les environs
11ème siècle avant notre ère – une ville protohistorique à Toulouse.
6ème siècle avant notre ère – Aquitains et Ibères en Occitanie.
3ème siècle avant notre ère – Les Volques Tectosages (peuple celte) en vallée de la Garonne.
121 avant notre ère – Romains et Volques Tectosages sont alliés dans la Provincia romana.
107 avant notre ère – Les Romains à Toulouse soumettent les Volques Tectosages révoltés.
416 – Les Wisigoths ont Toulouse comme capitale.
507 – Les Francs battent les Wisigoths, les chassent en Languedoc, dynastie Mérovingienne.
751 – Dynastie Carolingienne, le métissage entre Gallo-romains et Francs est effectif.
987 – Dynastie Capétienne, royaume franc.
Histoire du village de Sainte-Foy-de-Peyrolières depuis sa fondation
L’appel aux moines (1050-1070)
Vers 1050, Hélie seigneur de Samatan possédait les terres de Pérairols, (nom qui a probablement évolué en Peyrolières) qui étaient constituées majoritairement d’une immense forêt. Il décida de faire don d’une partie de cette propriété aux moines bénédictins de l’abbaye de Conques, connue par les miracles de sa protectrice sainte Foy. Dans ce don, il renonça aux bénéfices qui résulteraient de l’exploitation des terres.
Les moines défrichèrent les bois, érigèrent une église et une ville fortifiée de forme carrée, entourée de profonds fossés, sur un point haut, pour assurer leur sécurité. Le seigneur de Samatan et l’abbé de Conques furent co-seigneurs des terres.
L’essor médiéval (1050-1120)
Vers 1070, le fils d’Hélie, Odon de Samatan fit un don complémentaire dans lequel comme son père, il renonça aux bénéfices qui résulteraient des revenus des terres cultivées. Ce deuxième don ouvrit, un peu avant 1100, la voie à la création de la Salvetat, une deuxième aire de défrichage sur le point le plus haut de la commune.
Les moines y créèrent un village protégé par des fossés, organisé en sauveté qui était une zone de refuge et de franchise où les paysans bénéficiaient de privilèges et de la sécurité. Ceci favorisa le peuplement et la mise en valeur des terres vierges.
Les errements des comtes de Comminges (1120-1255)
À l’extinction de la maison de Samatan, les comtes de Comminges devinrent co-seigneurs. Bernard IV de Comminges entra en conflit avec l’abbé de Conques afin de retrouver les droits abandonnés par les comtes de Samatan. Après le meurtre d’un moine en 1231, il fut excommunié sur l’ordre du pape et dut se soumettre.
De même lors de la croisade contre les Albigeois, Bernard IV fut allié du comte de Toulouse contre le chef militaire de la croisade, Simon de Montfort qui les mis en déroute. IIs durent se soumettre au roi de France Louis VIII. En 1254, Bernard VI de Comminges, s’étant mis au service du roi d’Angleterre fut dépossédé de ses terres au profit du comte de Toulouse Alphonse de Poitiers, nouveau co-seigneur de Sainte-Foy-de-Peyrolières.
La prépondérance administrative (1255-1348)
En 1255, un paréage (contrat de droit féodal avec égalité des droits seigneuriaux) fut signé entre l’abbé de Conques et le comte de Toulouse. Une charte des coutumes fut alors accordée aux habitants, tandis que des consuls furent installés afin de s’occuper du service de la ville.
Avec l’administration du comté de Toulouse en sénéchaussées et en jugeries royales, Sainte-Foy-de-Peyrolières devint chef-lieu de châtellenie en 1270. Elle comportait 18 villages dont « St Lis, Fonsorbes, Seisses, Auradé, Sajas, Le Lerm, Forgues et Rioumes… »
Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, n’ayant pas eu de descendant, la co-seigneurie de Sainte-Foy-de-Peyrolières revint aux nouveaux rois de France, les Capétiens en 1271. En 1326, il est attesté qu’il y avait un maître d’école membre du clergé.
Le temps des désastres (1348-1562)
Une épidémie de peste fit disparaître plus des deux-tiers des habitants en 1348. Il s’en suivi une famine importante.
Dès 1350, les moines n’étaient plus présents à Sainte-Foy-de-Peyrolières tandis que l’abbaye de Conques avait été incendiée en 1341 et ne fut reconstruite qu’en 1420.
L’attribution de la couronne de France à un Valois en 1328 fut à l’origine de la guerre de cent ans (1337-1453). En 1355 le prince Noir pilla les campagnes de Bordeaux à Béziers. Ce fut la ruine de la Salvetat dont le corps consulaire ne fut pas remplacé.
Les compagnies de soldats licenciés ravagèrent le pays en torturant les habitants pour leur extorquer des rançons de 1364 à 1368.
Du XIVème au XVème siècle, les survivants n’étaient plus en capacité d’éviter la misère. Les métairies étaient abandonnées et les terres cultivables étaient devenues des terrains vagues.
La crise religieuse (1562-1620)
L’arrêt du Parlement de Paris ayant mis les protestants hors la loi en 1562, ceux-ci s’armèrent et assiégèrent, puis pillèrent Sainte-Foy-de-Peyrolières en 1577.
Les voleurs semèrent la terreur de 1584 à 1585 sur les routes autour de Sainte-Foy-de-Peyrolières, soutenus par les Huguenots installés à l’Isle-Jourdain.
La communauté de Sainte-Foy-de-Peyrolières reconnut comme roi légitime Henri IV vers 1595, elle aura connu 25 ans d’exactions par ces guerres de religion.
Le court répit jusque vers 1620 fut marqué par un essor des activités, des constructions, l’apparition de l’art dans les maisons des nobles et des bourgeois, ainsi que l’arrivée de nouveaux co-seigneurs ; les Bourbons et les Jésuites du Collège de Toulouse.
L’avidité du pouvoir royal et du pouvoir ecclésiastique (1620-1789)
Pendant plus d’un siècle, de 1635 à 1750, Sainte-Foy-de-Peyrolières fut ville d’étape et de quartiers d’hiver pour les troupes en déplacement, ceci aux frais de la communauté. Ces troupes royales n’hésitaient d’ailleurs pas à piller les habitants.
Après des épisodes de peste en 1631 et 1653, un hiver très froid en 1709 et des impôts écrasants à partir de 1718, une épizootie décima les bêtes à cornes en 1775.
De leur côté, les Jésuites refusèrent de faire les réparations de l’église en mauvais état dès 1702 et obligèrent la communauté à dépenser d’énormes sommes en procès. Une partie de l’église était tombée en 1739 quand le jugement en forme de conciliation partagea les responsabilités entre les co-seigneurs.
Le choc révolutionnaire (1789-1815)
En majorité, la population du village ne souhaitait pas maintenir tel quel l’ordre des choses, à la fois chaotique, considérablement inégalitaire et despotique. Personne ne voulait apparaître comme conservateur, mais pas davantage ennemi de la monarchie et partisan de la république.
La tournure que prirent les évènements en troubla plus d’un. La terreur, les bouleversements religieux et sociaux, pour finir par la disette, ne répondaient pas aux attentes de cette population. Il n’y eut pas de morts à déplorer, seulement quelques emprisonnements pour délits d’opinions.
Les structures administratives féodales furent abandonnées au profit des départements, arrondissements et cantons. La ville de Saint-Lys, commercialement plus dynamique est alors désignée chef-lieu de canton à la place de Sainte-Foy-de-Peyrolières ancien chef-lieu de châtellenie. À l’époque, les deux villages avaient une population équivalente d’environ 880 habitants.
C’est en 1791 que s’acheva la reconstruction de la troisième église.
L’approche des temps modernes (1815-1945)
A Sainte-Foy-de-Peyrolières, on ressentit à peine le contrecoup des révolutions parisiennes de 1830, 1848 et 1870.
En 1848, à la chute de Louis Philippe, les électeurs de Sainte-Foy-de-Peyrolières et des communes voisines votèrent à 88 % en faveur de Louis Napoléon Bonaparte.
En 1860, la population était remontée à 1500 habitants.
Le clocher qui était en ruine en 1844 fut reconstruit pour la troisième fois en 1857.
En 1880 fut achevée la construction d’un nouvel hôtel de ville comprenant des salles d’école et les logements des instituteurs et institutrices. La halle fut détruite sur ordre de la préfecture et reconstruite en 1893 sur les douves partiellement comblées.
En 1900 s’ouvrit une ligne de chemin de fer allant de Toulouse à Sainte-Foy-de-Peyrolières, puis à Boulogne sur Gesse l’année suivante.
En 1914-1918, 220 hommes ayant entre 18 et 50 ans furent mobilisés pour cette guerre. Il y eu 47 morts sur la commune.
En 1939-1945, il y eu des poches de résistance sur la commune, mais pas de mort parmi les hommes mobilisés ou résistants.
Références :
(1) – Jean Contrasty – Histoire de Sainte-Foy-de-Peyrolières – 1917
(2) – Jean-Marie Igounet – Sainte-Foy-de-Peyrolières de 1615 à l’an XII de la République – 1872
(3) – Jean-Clair Dauriac – Monographie de Sainte-Foy-de-Peyrolières – 1885